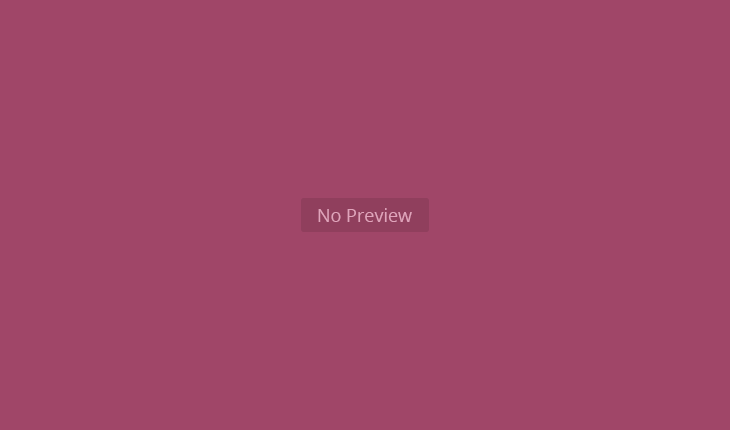Mansour M’henni
C’est vraiment étonnant de voir combien la dernière proposition du Président de la République à propos des droits de la femme a pu susciter des réactions et des comportements des plus contradictoires chez les citoyens tunisiens, en dehors de toute considération politique. Ce qu’on découvre alors, c’est que l’idée que nous avons de notre peuple, en matière de modernité, mérite peut-être d’être relativisée ; surtout qu’à la fin, la question se réduit soit à l’opposition des modernistes et des passéistes, soit à la revendication, par chacun des deux camps, du monopole de la modernité, de façon à donner à ce mot à la fois le sens et son contraire.
Y a-t-il une relation de cause à effet entre cet état des choses et le fonctionnement des partis politiques ? Difficile d’être catégoriquement affirmatif. Il n’y a cependant pas de doute que c’est une question de mentalités, d’éducation et de culture, le tout convergeant vers la question de l’éthique. C’est dire qu’il ne suffit pas d’user du mot « révolution » jusqu’à l’inflation pour voir se réaliser une vraie révolution. Celle-ci est un processus pérenne et évolutif, agissant à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Pour revenir à la question de la femme, à l’occasion de la proposition du Président, le Code du Statut Personnel a été remis sur la table de discussion ! Pourquoi pas ? A condition de l’ouvrir sur l’évolution et non sur la régression. C’est peut-être ce que le Président a voulu initier. Pour le meilleur et pour le pire ? A la société donc de choisir le meilleur, si tant est qu’elle est capable de s’entendre sur ce « meilleur ».
De fait, il n’est pas de ce propos de gloser philosophiquement sur cette question ; j’ai juste senti le besoin d’en parler à partir de deux comportements que j’ai constatés et qui me donnent à réfléchir. Le premier est celui d’une femme devant moi, en file plutôt longue pour payer la facture de la STEG à Menzah VI. D’habitude, il y avait deux guichets, mais on comprend qu’au mois d’août, le mois privilégié pour les congés administratifs, il n’y en ait qu’un seul qui fonctionne. Lasse d’attendre ou peut-être pour une autre motivation, la dame, bien poudrée et élégamment accoutrée, est allée alertement crier, à la face du fonctionnaire du guichet, son indignation de cet état des faits (autrement dit « qu’il n’y ait qu’un seul guichet ») et lui a demandé d’aller voir le Directeur et de lui demander, au besoin, d’occuper lui-même le second guichet.
Il va sans dire que le fonctionnaire du guichet n’avait que répondre et que la dame ne pouvait que nous retarder davantage par sa discussion mal à propos, me sembla-t-il. Je lui ai donc signifié que ce monsieur n’y pouvait rien et que si elle le voulait, plutôt que de nous retarder, elle pouvait aller présenter ses doléances ou ses contestations directement au directeur, faute de quoi elle pourrait même communiquer cela à la presse. Elle s’est alors emportée davantage pour me dire : « Si j’étais un homme, vous n’auriez pas osé me faire la remarque, mais la femme reste toujours inférieure chez vous ». Personne autour de moi ne comprenait son argument ; j’ai commenté alors que c’était dans l’air du temps.
Cela a réactualisé en moi une autre situation plus cynique et plus cruelle, celle de certains commentaires, toujours trop nombreux pour la circonstance, notifiés à propos du statut sur facebook rendant compte du décès de deux médecins, une mère et son collègue, qui se sont noyés en sauvant l’enfant de la défunte. Pendant que tout le monde compatissait, avec un sens certain du sacrifice, dont devrait se doter tout médecin authentique, et avec même une admiration certaine, d’autres s’attaquèrent effrontément au souvenir et à la réputation de la décédée, trouvant qu’elle avait mérité son sort du fait d’un manquement à la pudeur et à la morale en allant se baigner avec un collègue. Pourtant, ce dernier était lui-même en compagnie de son épouse et son geste était d’une humanité dont ces commentateurs moralisateurs n’auraient même pas le soupçon. Obscurantisme oblige !
Je me garderais bien d’analyser plus profondément ces deux situations que j’ai rapportées non sans une subjectivité certaine. J’espère seulement qu’à leur propos, chacun, en bonne âme et conscience, et de sa voie intérieure comme dirait Malraux, se pose les questions qui se doivent pour en raisonner les effets et les causes. Peut-être commencerons-nous alors à penser vraiment notre révolution.
Mansour M’henni