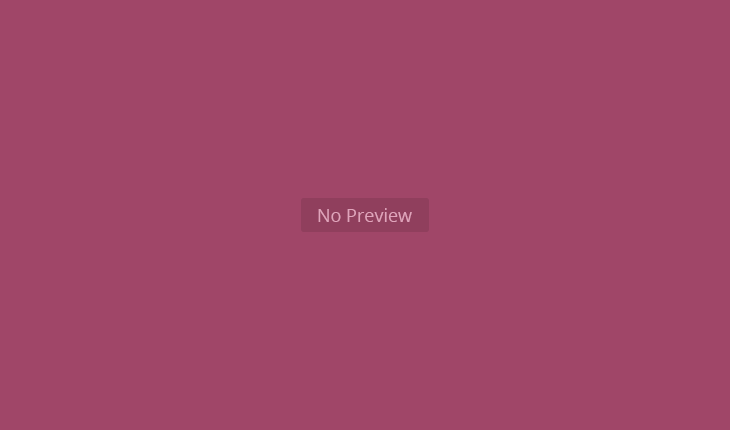C’était du temps où El Haouaria n’était qu’un petit hameau blotti dans un vallon pour se protéger des vents du Nord-Ouest et des ressacs d’une mer souvent déchaînée.
Il n’y avait ni eau courante, ni électricité, ni route goudronnée, ni réseau d’eau usée .
Chaque maison ou plutôt chaque gourbi avait à l’entrée un tas de fumier où aussi bien les bêtes que les humains allaient se soulager.
On appellerait cela, aujourd’hui, du recyclage biologique .
L’Ecole primaire franco-arabe d’El Haouaria ne comprenait que deux salles de classe où l’instituteur-directeur dispensait des cours pour trois niveaux différents en même temps .
La plupart des élèves y allaient souvent pieds-nus, maigres comme un clou, le corps flottant dans des blouses informes où les lambeaux de rapiéçages étaient si nombreux qu’ils couvraient le tissus initial .
L’instituteur-directeur de service, appliquant à la lettre des règles d’hygiène élaborées en Métropole, nous alignait chaque matin en rangs serrés devant la salle de classe pour contrôler l’hygiène de nos oreilles et de nos ongles et ne regardait même pas nos pieds nus bouseux en hiver et poussiéreux en été .
C’est qu’en France où vivaient nos « Ancêtres les Gaulois », il était impensable qu’on vînt pieds nus à l’école .D’où l’absence d’une telle procédure de contrôle au niveau des pieds.
Mais passons et parlons de Mouled .
Ma mère, grande femme rurale au teint laiteux oxydé par le soleil de l’été et les embruns salés des rigueurs hivernales, aux cheveux roux-henné, habillée souvent d’un Kadroun rouge pourpre en laine épaisse, de Farmla et de Fouta rayée serrée au corps par un joli gros nœud légèrement désaxé et volontairement négligé, se réveillait très tôt les matins de Mouled .
Comme il n’y avait pas de cuisine, à proprement parler, toute l’activité de préparation des aliments se passait dans un coin de l’immense patio, un espace noir de fumée surnommé « Kchina »où trônaient l’incontournable Tabouna, les réserves de branchages servant de combustible, le chien aboyeur attaché près des brebis et un capharnaüm d’objets souvent inutiles qui, disait-on, pourraient un jour servir .
On ne sait jamais !
Ma mère qui avait compté neuf (9) enfants devait allumer le feu de bois, un bois souvent trempé par les trombes d’eau hivernales. Elle se mettait à quatre pattes pour souffler sur un départ de feu laborieux et récalcitrant. Elle ne s’en relevait qu’après un long moment, épuisée, les genoux ankylosés et les yeux larmoyants par l’effet des fumées et des gaz dégagés .
Elle mettait une immense N’hasa ( gros chaudron en cuivre ) sur le feu et la calait par une branche en Y (El Forka) sur laquelle elle devait appuyer son genou de tout son poids. Et d’une grande spatule en bois ( El Madlek ), elle malaxait, sans répit, un mélange de farine et d’eau ( eau chaude de préférence ) .
En même temps, elle devait alimenter constamment le feu du brasier de fortune pour éviter la chute de température et la formation de grumeaux .
Et quand l’Assida blanche était prête, elle en remplissait des plats qu’elle saupoudrait de sucre. Elle prenait bien soin de faire un petit creux au milieu de chaque plat qu’elle remplissait d’une huile d’olive qu’elle avait elle-même triturée et pressée .
La plus grosse bassine d’Assida (Kasaa) était destinée à la rue .
Oui, c’était la tradition à El Haouaria .
Chaque maison devait « sortir » un grand plat d’Assida pour les habitants mâles qui, tels des fantômes, après la prière du Fejr à la mosquée, sortaient tous faire le tour du village pour goûter aux différentes Assidas .
Celles au miel ou les plus abondamment sucrées étaient évidemment les plus courues et les plus sollicitées .
La meilleure Assida était louée par tous les dégustateurs et faisait le « Buzz » de bouches à oreilles, comme on dirait de nos jours.
Aujourd’hui, quand j’y pense, je me dis que cette tradition de partage, au delà de son caractère convivial, avait peut être pour objectif de « niveler » toute la population du village et de mettre à l’aise tous les pauvres qui n’auraient pas eu ainsi à quémander une platée d’Assida .
Tout le monde, les riches comme les pauvres, devenait « pique assiettes » publics en quelque sorte .
C’était la magie des premières heures du Mouled .
Toutes les femmes donnaient l’impression de participer à un concours et leurs cœurs battaient la chamade dans l’attente du retour de leur bassine d’Assida .
Vide et « léchée »jusqu’au fond comme on dit, elles en tiraient une réelle fierté qui leur faisait pousser des youyous de joie .
Pleine ou à peine entamée, elles en devenaient malades pour la journée .
Le maître de maison, aussi .
Une fois ce devoir de partage accompli, ma mère venait nous réveiller pour nous placer, telle une mère-poule, autour d’une Kasaa fumante dans laquelle on piochait volontiers, quitte à nous en brûler la bouche et les doigts .
À l’époque, on ne savait même pas ce que « Assida zgougou » voulait dire .
Wahid Ibrahim