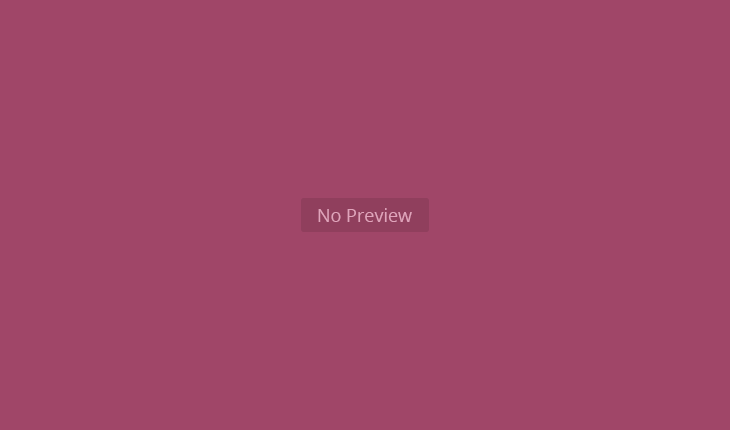Annoncée en octobre 2017 en réponse à plusieurs résolutions de l’organisation qu’ils jugent «anti-israéliennes», la décision prise par Washington et Tel-Aviv de quitter l’Unesco prend effet à partir du 31 décembre à minuit. L’organisation internationale regrette ces deux retraits mais minimise leurs impacts.
Un an après l’avoir annoncé, les Etats-Unis et Israël se sont officiellement retirés de l’organisation pour l’éducation, la science et la culture des Nations-Unies, basée à Paris.
Ils l’avaient annoncé l’an dernier, c’est désormais acté. Les États-Unis et Israël ne font officiellement plus partie de l’Unesco, l’organisation pour l’éducation, la science et la culture des Nations-Unies, depuis le 31 décembre, à minuit.
Les prises de positions « anti-israéliennes » de l’Unesco. Accusant l’institution d’être « anti-israélienne », les États-Unis avaient annoncé dès le 12 octobre 2017 leur intention de se retirer de l’Unesco. Dans la foulée, l’État hébreu avait décidé de quitter l’organisation, qualifiée par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou de « théâtre de l’absurde où l’on déforme l’histoire au lieu de la préserver. »
Les États-Unis conserveront toutefois un statut d’observateur, avait précisé le Département d’État américain il y a un an.
Une crispation continue depuis des années. Cela fait plusieurs années que les relations entre les États-Unis, Israël et l’Unesco sont tendues. Au point que depuis sept ans et l’entrée de la Palestine comme État membre, les deux pays ne lui apportent plus de financement. Depuis 2011, le montant des arriérés s’élève à 620 millions de dollars pour les États-unis, 10 millions pour Israël. Les deux États devront s’acquitter de leurs dettes.
En juillet 2017, l’Unesco avait plus que froissé Israël en inscrivant sur la liste du patrimoine mondial en danger la Vieille ville d’Hébron occupée. L’organisation onusienne y indiquait qu’Hébron, située en Cisjordanie occupée, était une ville islamique. Actuellement, une poignée d’Israéliens y vivent, au milieu de 200.000 Palestiniens. Ce dernier épisode avait fini de convaincre les deux alliés de quitter l’organisation.
Washington n’est pas à son premier coup de théâtre
Les Etats-Unis ne sont pas à leur premier coup de théâtre. Il y a eu un précédent, en 1984, sous Ronald Reagan, alors motivé par l’inutilité supposée et les débordements budgétaires de l’Unesco. Ce n’est qu’en 2002 que les Etats-Unis avaient réintégré l’organisation.
La décision prise par Washington, suivi par Tel-Aviv, de se retirer de l’Unesco en pleine élection du directeur de l’organisation avait suscité bien des interrogations. Pourquoi avoir choisi un moment où le vote des 58 pays membres avait sorti au final un candidat qatari, l’ex-ministre de la Culture Hamad Ben Abdoulaziz Al-Kawari, et une candidate française, elle aussi ex-ministre de la Culture, Audrey Azoulay, qui étaient pourtant les moins soupçonnés d’antisémitisme ou d’attitude anti-israélienne parmi tous les candidats en lice. Car, ni le Qatar, qui entretient des relations quasi assumées avec Israël depuis longtemps, encore moins la France, représentée par la fille du principal conseiller du roi du Maroc, André Azoulay, connue pour ses positions pro-israéliennes, n’auraient pu être, à l’avenir, un obstacle à la politique israélienne, puisque c’est le principal reproche qui était fait à la direction sortante.
Pour maquiller leurs accusations, les Américains ont ressorti une vieille histoire où la presse occidentale avait reproché au candidat qatari d’avoir «observé le silence» à la présence de livres jugés antisémites au cours d’un salon de livre lorsqu’il était ministre de la Culture.
Avec agences