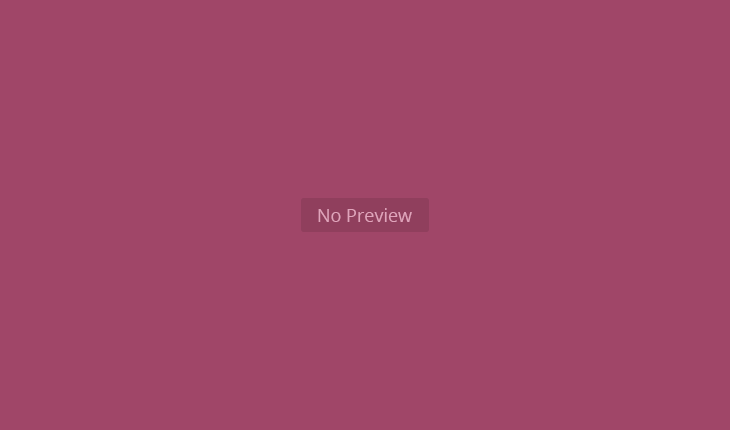Mansour Mhenni
Nessma Life a invité, vendredi 17 février 2017, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Slim Khalbous, le lendemain même de l’invitation d’un représentant du syndicat IJABA (L’Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens) qui a appelé à une grève des enseignants universitaires, le 23 du mois courant. Ce fut une occasion pour confronter les arguments de chacune des deux parties concernées, le ministère et le syndicat.
J’avoue d’emblée que les réponses de Slim Khalbous à toutes les questions posées ont été très convaincantes, le ministre n’hésitant pas, au nom de la sincérité et de la transparence, à souligner la distinction nécessaire entre ce qui est possible dans le délai proche et ce qui ne pourrait se réaliser qu’à moyen ou à long terme. Nous avions écrit, ici même, en guise de « chuchotement à l’oreille du ministre », une chronique suggérant certaines idées pour l’entreprise de révision du secteur, et nous sommes confortés de constater que ces suggestions, et bien d’autres encore, font l’objet des réflexions qui président à la réforme du secteur. Ainsi, le premier semestre de 2017 aura clos le dossier de la conception de cette réforme sur la base d’une évaluation profonde et d’une concertation largement démocratique. Tout y est, nous dit le ministre, et tout est articulé à la condition et à l’impératif réalistes.
Tout cela pourrait rassurer, au moins provisoirement, en attendant les mises en application et le suivi parallèle d’évaluation, et de rectification si le besoin se fait sentir. Ne l’oublions pas, le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, comme celui de l’Education, est un nerf moteur de la société et un actant déterminant de sa nature. C’est dire la gravité (dans les deux sens du mot) de toute responsabilité impliquée dans son bon fonctionnement, depuis la responsabilité gouvernementale jusqu’à la responsabilité citoyenne. Or, ce qui est à craindre, c’est que la tension actuelle entre le ministère et IJABA soit sans vrai rapport direct avec le fond des problèmes du secteur et qu’elle soit dictée par des tiraillements politiques où se seraient fourrés des sensibilités partisanes et des considérations de rapports des forces dans le pluralisme syndical. On n’en voudrait pour preuve que l’appel d’IJABA à une grève, quelques jours seulement après la nomination du ministre actuel.
Ne nous attardons pas sur l’interprétation, qu’il conviendrait de ne pas négliger, selon laquelle IJABA serait un syndicat d’obédience pro-islamiste, par conviction ou par simple coalition, avec pour objectif de contrer ce qui est considéré comme un hégémonisme de l’UGTT, sous influence gauchiste.
N’empêche que, au-delà de l’implication ou non des deux sensibilités politiques évoquées, il y a bien un vrai problème de représentativité et de légalité en contexte pluri-syndical. On reprocherait alors au ministère du secteur de ne pas procéder aux négociations sociales avec IJABA, comme il le fait avec l’UGTT. Or, comme expliqué, l’argument n’est pas sectoriel mais national, puisque les négociations sont légalement commandées par la plus grande représentativité, faisant ainsi de l’UGTT le seul partenaire direct des négociations, au moins dans l’Etat actuel des choses. Mais cela n’a pas empêché le ministre, semble-t-il, d’inviter le syndicat IJABA aux concertations pour la réforme de l’Enseignement Supérieur et la Recherche. Toutefois, le syndicat aurait refusé l’invitation. Quant à la représentativité dans les négociations, c’est une question qui se revendiquerait autrement et avec le vis-à-vis décisionnel à cet objet.
En définitive, il serait sûrement plus constructif, pour le secteur et pour le pays, pour les concernés également, que tout le monde se conforme à l’esprit conversationnel et à la logique constructive, loin des influences et des tiraillements politicards car, au vu des dégâts constatés, ce serait très grave de perdre encore un temps par trop précieux à tergiverser sans avancer.
Par Mansour M’henni
Mise à jour samedi 18 février : IJABA réagit violemment
Nous avons publié, vendredi 17 février 2017, une chronique commentant le passage de Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à l’antenne de Nessma Life, à propos de la grève décidée par l’Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens (IJABA) pour le 23 février 2017. Cette chronique a suscité la colère des dirigeants d’IJABA qui y ont vu une prise de parti « gratuite » contre leur structure syndicale, malgré toutes les nuances et les précautions qui y sont prises, le conditionnel aidant, pour nuancer les données et relativiser les informations.
Quoi qu’il en soit, nous considérons que le journalisme d’opinion se fonde sur les différences et sur le pluralisme des idées, dans le respect réciproque, sinon notre rêve de démocratie resterait un vœu pieux. C’est pourquoi nous avons demandé aux responsables de nous fournir des données à même de rétablir l’équilibre auquel nous aurions manqué. Ils ont été gentils de nous envoyer une vidéo de plus de quarante minutes où le coordinateur général d’IJABA, Najmeddine Jouida, et le coordinateur général adjoint, Zied Ben Amor, expliquent, au micro de Saraha FM, les raisons qui les ont poussés à la grève. En voici une synthèse, aussi fidèle que possible à leur pensée :
« La grève est pour nous une contrainte. Elle a été décidée suite à une concertation, par Internet, avec les universitaires que nous avons trouvés très en colère. En effet, cela fait des années qu’il n’y a rien de nouveau ni de profond dans ce qui se décide pour l’Université tunisienne. Aucune discussion et nulle méthodologie scientifique. Le résultat est que les universitaires désertent le pays où vivent dans un malaise incurable.
Nous avons cherché à avancer des propositions ! Pas de réponse. Nous pensons que le ministère et l’Etat ne respectent pas les universitaires. A titre d’exemple, nous subissons des déductions sur nos salaires de façon arbitraire, alors que des augmentations sont accordées à d’autres secteurs de la fonction publique.
Il y a aussi une injustice flagrante à l’égard des collègues qui encadrent des travaux de recherche : ils ne sont payés qu’à partir du troisième travail abouti. S’ils n’en font que deux, leur effort est gratuit. Il y a même un accord conclu à ce propos, mais jamais conduit jusqu’à l’application.
Par ailleurs, les soutenances se font parfois à des distances supérieures à cent kilomètres ; l’enseignant se déplace à ses frais, sans même un ordre de mission qui le couvrirait en cas d’accident ou autre imprévu.
Il y a un vrai blocage du dialogue. Nous avons écrit au niveau ministre et nos écrits sont restés sans réponse. Nous avons la conviction que nous pouvons contribuer efficacement à la réforme du secteur, mais on ne nous écoute pas. Finalement ce qu’on appelle une réforme, ce n’est que du maquillage.
Nos revendications portent surtout sur les conditions de travail, sur l’absence de motivations, surtout pour les chercheurs. Par exemple, pourquoi ne pas encourager la publication scientifique par une subvention de motivation ? Pourquoi arrêter les abonnements aux revues scientifiques internationales pour les remplacer par des tickets de restaurant pour le personnel ?
Nous ne voulons pas que l’universitaire soit obligé de chercher un deuxième travail pour subvenir aux besoins de ses enfants et de leurs études, ni que les parents soient forcés d’envoyer leurs enfants dans le privé par manque de confiance dans l’université tunisienne, comme le prouve la régression de nos universités au classement international.
Certains politiciens se prétendent d’inspiration bourguibienne, pourtant ils sont en train de détruire l’ascenseur social qu’était l’enseignement pour Bourguiba.
A tout cela s’ajoute une bureaucratie enrouée et un mode du scrutin pire que les désignations de l’époque Ben Ali, car déformant le principe de la représentativité universitaire.
Quant au régime LMD, parachuté chez nous sans prise en compte des conditions objectives, manquant de moyens d’évaluation et de suivi, il est à revoir à l’amélioration pour le court terme, en attendant d’initier, de façon largement concertée, un régime adapté à notre pays. »